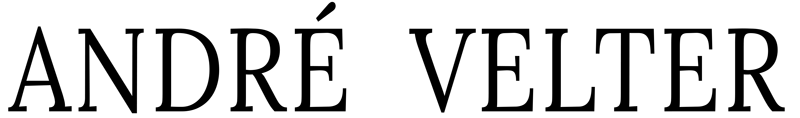Un poète six peintres
André VELTER
Bernard MONINOT, Paul REBEYROLLE, Antonio SAURA, Antonio SEGUI, Vladimir VELICKOVIC, ZAO WOU-KI
Préface Jean-Luc CHALUMEAU, textes André VELTER
Musée Rimbaud, Charleville-Mézieres, avril 1992
L’Oreille de Van Gogh
et la Jambe de Rimbaud
Fantin-Latour fait le portrait de Rimbaud en compagnie de Verlaine, mais ne le représente pas dans le célèbre Atelier aux Batignolles. Il est vrai qu’Arthur n’a jamais écrit une ligne sur lui (on le comprend), ni d’ailleurs sur aucun autre artiste contemporain.
C’est que la vie n’a pas offert au poète de fortes rencontres avec des peintres de son niveau. C’est seul qu’il infuse aux mots ordinaires un sang brûlant, comme Van Gogh aux formes des plus humbles objets.
Rimbaud n’aura pas été l’ami de Van Gogh, mais Baudelaire fut celui de Manet et Eluard celui de Picasso… Le révolté de Charleville semble donc faire exception dans la tradition très française des poètes dont l’écriture noue des liens intimes avec quelques peintres élus.
André Velter appartient d’évidence à cette tradition, et parmi les peintres qu’il aime on trouve Bernard Moninot, Paul Rebeyrolle, Antonio Saura, Antonio Segui, Vladimir Velickovic et Zao Wou-Ki.
Mais Velter s’interdit de les appeler « ses » peintres : parce qu’ils sont d’abord ses amis, ils font simplement partie de sa vie, et par conséquent de son oeuvre.
« Qui donc a dit que le dessin est l’écriture de la forme ? demandait Manet, la vérité est que l’art doit être l’écriture de la vie. » En ce sens, l’art du poète et l’art du peintre sont de la même sorte.
Les rencontres de Velter avec les peintres suscitent moins chez lui le commentaire que la création parallèle. Les démarches vont alors de pair, l’une interrogeant l’autre sans que l’homme d’écriture cherche à déchirer des écrans ou à formuler des analyses : pour lui, il est toujours possible d’entrer dans l’univers d’un peintre sans commettre d’effraction. « Personne ne tient la frontière qui mène du signe au songe » écrit-il dans Le Messager, poème dédié à Bernard Moninot.
Il serait vain de vouloir établir des relations formelles entre les six peintres présentés aujourd’hui par André Velter. Quels points communs établir entre la représentation de Velickovic affrontant une matière hallucinée « comme si le réel n’était que le cauchemar précipité des êtres et des choses » et les lumineuses abstractions de Zao Wou-Ki ?
Quels rapports inventer entre la formidable énergie de Rebeyrolle, l’humour aristocratique de Segui, la figuration écorchée des grandes gouaches de Saura, l’ésotérisme subtil des verres de Moninot ?
Nulle parenté de style, vraiment, mais bien une fraternité profonde : celle-là même qui relie chacun d’eux au poète et qui ressemble fort à celle évoquée par Eluard quand il parle des frères voyants (on nommait ainsi, autrefois aux Quinze Vingts, les hommes non aveugles mariés à des femmes aveugles).
Le poète et le peintre sont doués l’un et l’autre du sens de la vue, et parce qu’ils nous font oublier notre propre cécité, ils sont nos frères voyants.
Le poète et le peintre nous font voir ce que nous ne pourrions pas discerner sans eux ; et voyant ce qu’ils nous font voir, nous voici profondément dépaysés. « Mon pays fut l’envers de mon pays – mon pays est un dépaysement » écrit encore André Velter.
Dans ce pays, comme dans celui des peintres, tout est permis et n’importe quel « morceau » pourra pénétrer, pourvu qu’il soit « choisi ». Seront donc par exemple réunis, chez André, le crâne d’Eschyle, l’oreille de Van Gogh, le bras de Cendrars et, naturellement, la jambe de Rimbaud…
Jean-Luc Chalumeau
MONINOT
L’Hôte de la Transparence et du Vide
Le premier dessin exposé de Bernard Moninot, en 1967, était une encre de Chine sur papier qui s’intitulait Chambre blanche. On ne peut imaginer titre initial mieux choisi puisqu’en vingt-cinq ans l’oeuvre toute entière s’est développée comme si l’artiste avait décidé de quitter cette chambre par la fenêtre pour ne plus répondre qu’à l’appel exclusif de la lumière.
Avec du verre, du graphite, de l’encre, de la chaux, de la poussière, du cuivre, du laiton, de la silice, avec au départ une rigoureuse maîtrise du trait puis un sens aigu de l’épure, Moninot a questionné les sédiments de l’ombre et les traces du jour.
Les grandes séries de tableaux ou d’assemblages qui se sont succédées, des Vitrines aux Serres, de la Chambre noire à l’Observatoire, ont rythmé cette entreprise singulière vouée au silence des lieux, au silence des temps, à l’absence des êtres. Et cette qualité de silence des premières figurations n’a cessé de s’intensifier jusqu’à faire de ce silence vraiment visible l’hôte de la transparence et du vide.
Dans ses travaux les plus récents, Moninot a poursuivi sa quête méticuleuse. Au dessin tracé est venu de plus en plus se substituer le dessin « décoché », résultat d’une tension, spectre soudain révélé par projection, alliance d’une technique irréprochable et d’un actif principe d’incertitude. Les séries A ciel ouvert, Horizon, Les tours de poussières, Passerelles, Ondes claires ou Murmure du son n’utilisent plus que le verre pour support. Toutes suggèrent des architectures fragiles, précaires, présentées en situation intermédiaire entre mur et regard pour que le dessin se double d’une ombre changeante et que le motif apparaisse comme une lumière portée.
Avec une pratique de géomètre et d’arpenteur, Moninot crée de la magie pure. Son oeuvre a le naturel, la lucidité et la beauté d’une aube mentale. D’une aube qui éclaire le présent tout en plaçant sa modernité dans l’intemporel. Chacune de ses images est un envoûtement calme qui tient plus de la méditation que du songe.
AV

Ombres n° 3 1981 (Panoptique)
Peinture et pigments sur verres préparés 19 x 36 cm

Ombres n° 6 1981 (Panoptique)
Peinture et pigments sur verres préparés 19 x 36 cm
REBEYROLLE

Jeux de l’amour, 1986
260 x 195 cm
Une Exaspération Lucide
Dire Rebeyrolle, dire l’énergie-Rebeyrolle, dire sa force irréductible, sa geste révoltée, son emportement tonique, c’est marteler une évidence : Rebeyrolle est peintre. Fou, ivre, hanté, halluciné de peinture, enragé de couleurs, de brèches lumineuses, de précipités d’ombre, et vivant sa passion comme un exorcisme solitaire qui, plus loin que la cible du monde, veut atteindre, réaliser, incarner pleinement, douloureusement, presque fanatiquement, l’action de peindre.
Ici la création se donne et se prend à bras le corps. Comme un affrontement qui exulte, comme une submersion perpétuelle, comme un engendrement continu. Ce ne sont que pulsations obsédantes de la sève et du sang, du germe et de la dépouille, du foutre et du néant. Pulsations en écho d’une rumeur lointaine, abyssale, formidable, qui manifeste que l’inanimé n’existe pas, non plus que l’inertie ni le repos.
Car, avec Rebeyrolle, la matière n’a jamais été si goulûment nourricière, si saturée de vie, proliférante, débordante, jaillissante et répandue – pareille à une extension de pleine chair avec des cris à la place des os. Car la matière n’a jamais été menée, malmenée, malaxée, fouillée et figurée par une ardeur si véhémente, si acharnée à accomplir l’émergence de son trouble.
Qu’il peigne des paysages, des chiens encagés, des corps suppliciés, des nus englués dans leurs jeux et jouissances, voire des scènes mythologiques, Rebeyrolle use de tous les registres à la fois : le politique et l’intime, le parodique, le tragique, le tellurique. Sa perception est toujours violente, décapante, intraitable. Elle mêle le tournis des êtres à la pulpe de la terre.
Encore et encore, Rebeyrolle dit qu’il ne cédera pas son lot de tourment, son exaspération lucide, son refus de caresser le sein digeste des muses. D’ailleurs, au répertoire des arts libéraux, la muse des sculpteurs et des peintres n’a point de nom, et celle de Rebeyrolle est partie se baigner nue dans les cendres du Vésuve.
AV
SAURA
L’Œuvre au Noir
Dans l’héritage de la très catholique Espagne, Antonio Saura ne s’est réservé que la part du blasphème. Des ors et du sang il n’a gardé que les ombres violentes, des visages et des poses que les signes calcinés, des hommes et de l’Histoire que les processions sombres sur horizons livides, que les crucifixions pareilles à des nuits écorchées.
Entre exorcisme et expiation, son art est de balafre et de sarcasme. Il y a une sauvagerie du trait, une férocité toutes griffes dehors qui ne se soucient que du scalp des apparences, que des dépouilles en attente sous les masques, que des portraits dépulpés où l’identité ne tient qu’à la marque des dents. Avec Saura la mise à nu détache et tranche plus que les artifices ou la peau, et dans un cri de démiurge se change en mise à mort.
Cette dramaturgie ne se connait qu’un seul allié : le noir. Le poète Jacques Chessex parle d’ailleurs du « noir de Saura », comme on dit terre de Sienne ou bleu de cobalt, et il se laisse emporter, broyer, engloutir par « ce noir plus noir que d’encre noire, ce noir de macération et d’absence absolue d’espoir, ce noir de méditation enfermée dans sa catégorie, sa finitude – en même temps ce noir de la révolte noire, ce noir de l’injure à tout enfermement, ce noir métaphysique, ce noir d’autant plus noir qu’il se compose, qu’il joue avec tous les passages du noir à l’obscur dans le noir mental, ce noir qui ne « compose » pas… »
Œuvre au noir quant à son mystère baroque et à son alchimie de souffrances et de rires, l’œuvre d’Antonio Saura pousse en effet au noir avec une sorte de jubilation tragique. Par ses gestes maléfiques, ses collages iconoclastes, ses parodies grinçantes, elle tend à mettre au jour l’armature sacrilège du visible : la trame de néant qui hante et soutient les êtres et les choses. Sans doute cette aventure immense, cruelle, prométhéenne a-t-elle commencé « le jour où Satan avait décidé de se désintéresser de ce monde, et de l’abandonner en pâture à certain peintre plus capable que lui de regagner l’espace perdu. »
AV

Crucifixion n° 1/90, 1990
Technique mixte sur papier 75 x 56 cm
SEGUI

Time for a Stroll, 1990
150 x 160 cm
Le Monde appartient au Señor Gustavo
Elégance, désinvolture, ironie, peut-on passer dans la vie comme en dansant ? Deux pas en avant, un pas en arrière : Cordoba-Paris et retour, New York-Buenos Aires et retour, un pas de côté, un pas en arrière. On a de la nonchalance dans les genoux, une cambrure de cavalier, un chapeau mou, une cravate, une moustache impeccablement taillée. On ne sort pas de son rêve, on se réfugie dans le cadre, et si la tour Eiffel dépasse on la tord à angle droit comme un jouet d’enfant. On se nourrit du labyrinthe de toutes les villes aussi facilement qu’on y prendrait l’air du soir. Le señor Gustavo, le quidam emblématique d’Antonio Segui, est le piéton de l’univers urbanisé. Pourvu qu’il y ait un café, un trottoir, un quai, un décor d’immeubles ou de gratte-ciels, il est chez lui, courant, enjambant, se multipliant, occupant l’espace et même tissant tout l’espace de sa seule présence. Si la nature a horreur du vide, le señor Gustavo, lui, a horreur de la nature et du vide. En s’appropriant magiquement les images du monde, Segui poursuit indéfiniment le songe du gamin qui veut descendre toutes les avenues de la terre, explorer tous les bars, hésiter à tous les carrefours. Il ne conte pas d’anecdotes précises ni d’histoires particulières. Obéissant au seul principe du plaisir de peindre, il crée des fictions aléatoires, des pièges qui fonctionnent mine de rien et pousse le spectateur à libérer, au compte accueillant du señor Gustavo, ses récits refoulés. « Mes préoccupations sont uniquement picturales et plastiques, déclare Antonio Segui, j’ai la prétention de faire des tableaux. La lecture de mes tableaux n’est donc ni claire ni ambiguë. » Alors, quelle ligne de fuite reste-t-il ? Et quel clin d’oeil risquer ? Sans doute le regard du funambule qui ne sait s’il a encore du fil sous le pied, mais qui avance d’un coeur léger, avec aux lèvres un refrain d’amour en perdition.
AV
VELICKOVIC
Les Signes du Destin
Architecte et stratège, bâtisseur d’épouvante, Vladimir Velickovic a surtout exploré les limbes tourmentés de la Création. Peintre d’un monde sans Dieu, il lui appartenait de mettre l’enfer au présent, d’en capter le brasier et les ombres pour vêtir des destinées de cendre. Car l’horreur constitue le nerf visible de son univers, tandis que le néant en est comme le miroir caché. Son oeuvre ne se tient jamais en deçà du tragique et la tension exaspérée qui la fonde ne connaît nul repos. Pour être pleinement de son temps, Velickovic a pris les plus lointains repères et le seul thème qui soit : celui qui enchaîne les effets et les causes et dissèque les affres de la survie. Ce qui naît, attaque, s’enfuit, se défend et s’abîme, alimente la Grande Illusion, le flux des ombres sursitaires au mur de la caverne, la ronde des existences. Ainsi que le souligne Marc Le Bot : « La peinture de Velickovic semble renouer avec la plus ancienne tradition artistique lorsqu’elle se donne à déchiffrer comme une allégorie de la destinée. Elle est toute couverte des signes du destin. Et ce sont eux sans doute qui seront toujours les premiers perçus dans cette peinture. Ils renvoient tout homme à ce qui est donné pour l’universel de la condition humaine : à la naissance et à la mort ; à la sexualité, à l’animalité mais aussi à la connaissance. Et ils y renvoient sur un mode dramatique qui implique affectivement chaque spectateur. Chaque image y est marquée par la violence d’une action et par l’incertitude de la pensée devant l’évènement. »
Chez Velickovic, aucun atome ne dit la paix, aucune trace ne se tait. La chair ravinée objecte. Comme objectent les pals, les crochets, les filins, les perspectives et les plans. L’homme décapité poursuit sa chimère mortelle : avancée, effort, tension, défaite et retour. Son tremplin ouvre sur un gouffre, sur un mur, sur un mur profond comme un gouffre. Il y a là une détermination qui ne renonce jamais à sa densité de nerfs, de muscles et d’os. Cri fatal d’une fatalité qu’elle récuse, la peinture de Velickovic impose une approche physique de l’Histoire. Ses corps de craie se détachent d’une nuit sanglante et sombre. La mémoire répète ses amnésies. La représentation affronte une matière hallucinée, comme si le réel n’était que le cauchemar précipité des êtres et des choses.
AV

Paysage Fig. X, 1990
Huile sur toile, 210 x 150 cm
ZAO WOU-KI

Sans Titre, 1982
250 x 260 cm
Un Sortilège Aérien et Tellurique
Il est une oeuvre où l’emportement devient maîtrise, où l’excès I devient harmonie, où la lumière tumultueuse des limbes devient transparence du souffle, où la violence devient beauté : beauté physique, beauté rêvée, beauté de la matière et du vide. Cette oeuvre est celle de Zao Wou-Ki, celle d’un peintre qui a su capter les temps et les espaces, fondre les visions et accéder à l’universelle résonance. Pour cela il aura fallu un périple sans exemple. Né à Pékin en 1921, élevé près de Shanghaï, étudiant aux Beaux-Arts de Hangzhou, le jeune peintre n’a de cesse de confronter la tradition chinoise aux images qui lui parviennent des Impressionnistes, de Cézanne, de Matisse, de Picasso. Tres vite la confrontation tourne à l’affrontement, et Zao Wou-Ki décide de s’expatrier en 1948, de rejoindre Paris. Là, il veut tout voir, tout connaître, tout ressentir. En fait, cette immersion passionnée dans le champ artistique de l’Occident va insensiblement lui restituer sa source originelle, mais purifiée. Le legs chinois se trouve désormais débarrassé de la sclérose et de l’emphase, il est redevenu vivant, risqué, imprévisible. Alors s’imposent, tableau après tableau, et dans les lavis et les encres, les manifestations de ce « sortilège aérien et tellurique » célébré par René Char et qui est le signe de Zao Wou-Ki. Comme le souligne aussi Jean Leymarie, cette « oeuvre singulière reste inépuisablement ouverte dans sa splendeur physique et sa plénitude spirituelle. Elle assume avec un élan de plus en plus libre la symbiose totale entre l’Occident et l’Orient, entre l’énergie et la contemplation ». Car Zao Wou-Ki a fait du dialogue de la terre et du ciel un échange constant de secrets, et la chambre d’échos de toutes les métamorphoses. Les rochers du chemin semblent des nuages, et les nuages lèvent comme un charroi de pierres. La création unit ici d’un même mouvement le geste et la pensée, l’action et les emblèmes migrateurs du non-agir. Loin de la référence prométhéenne, de sa souffrance avivée et de ses dieux jaloux, Zao Wou-Ki a changé le défi en partage solaire, en vertige ébloui : il a volé du feu au vide.
AV